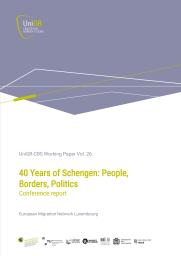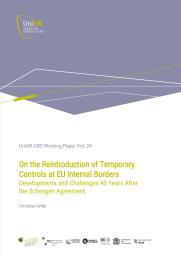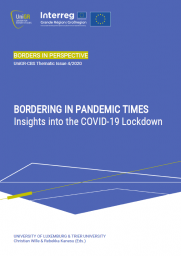Working Paper Vol. 26
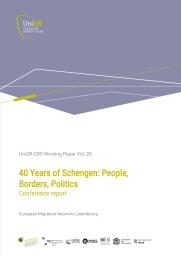
À l’occasion du 40e anniversaire de l’Accord de Schengen, la conférence « 40 ans de Schengen : populations, frontières, politiques », organisée conjointement par le REM Luxembourg et l’UniGR-Center for Border Studies, a offert une opportunité précieuse de célébrer l’intégration européenne tout en analysant de manière critique l’évolution des pratiques de gouvernance des frontières. Axée sur la libre circulation des personnes dans les régions frontalières, notamment dans l’espace SaarLorLux, la conférence a examiné les interdépendances socio-économiques, les tensions juridiques et les défis politiques liés à la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. Les interventions et tables rondes ont mis en lumière les dynamiques changeantes aux marges internes et externes de l’espace Schengen, où les discours sur la sécurité, les migrations et les crises géopolitiques ont contribué à reconfigurer l’esprit de Schengen. Les participant.e.s ont appelé à un engagement renouvelé en faveur des valeurs fondamentales de solidarité, de confiance et de souveraineté partagée, soulignant que l’avenir de Schengen nécessite une volonté politique forte ainsi qu’une mobilisation des citoyen.ne.s. La conférence a réaffirmé que Schengen est à la fois une réalité vécue, un symbole de la liberté européenne et un atout stratégique en période d’incertitude.