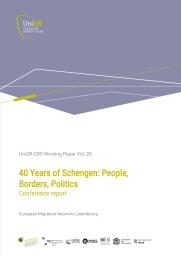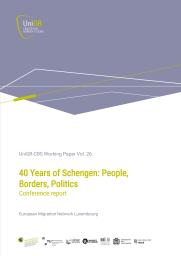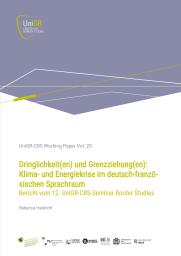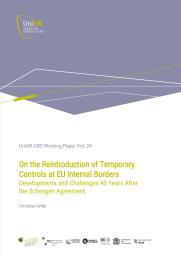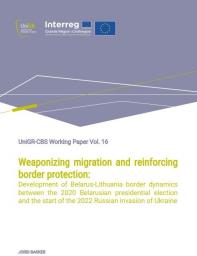Working Paper Vol. 27

Dans le cadre du projet « Common Ground SaarMoselle » soutenu par la fondation Robert Bosch, un conseil des citoyen.ne.s transfrontalier a été mis en place en 2024 dans une phase pilote sur le territoire de l’Eurodistrict SaarMoselle. L’objectif était d’impliquer activement les citoyen.ne.s venant d’Allemagne et de France dans l’élaboration des perspectives de développement de cette région frontalière commune. Le conseil, composé de 40 personnes, a élaboré des recommandations sur des thèmes centraux au cours d’un processus d’un an, lors de réunions plénières et d’approfondissement. Le groupe de travail Études européennes de l’Université de la Sarre a accompagné le projet par des enquêtes quantitatives et qualitatives. Comme le montrent les enquêtes, les participant.e.s du conseil jugent la vie dans la région frontalière très positive et considèrent la proximité avec le pays voisin comme une opportunité personnelle et sociale. La coopération est perçue comme une Europe vécue, et l’idée de la région frontalière comme « laboratoire de l’intégration européenne » est largement approuvée. Parallèlement, des événements tels que la pandémie de Covid-19 ou la réintroduction des contrôles aux frontières depuis 2024 montrent que les frontières ouvertes ne vont pas de soi. Le travail au sein du conseil des citoyen.ne.s est vécu comme enrichissant, tant sur le plan du contenu que sur le plan des relations humaines. L’atmosphère respectueuse, le multilinguisme fonctionnel et la possibilité d’apporter ses propres idées sont particulièrement soulignés. Un souhait est formulé : une plus grande participation des jeunes participant.e.s. L’influence concrète que le travail du conseil peut avoir sur les décisions politiques semble un peu trop vague. Une grande partie des membres se montre prête à participer à l’avenir à un conseil des citoyen.ne.s transfrontalier. Le conseil peut ainsi être considéré comme un instrument innovant pour une plus grande participation des citoyen.ne.s dans les régions frontalières.